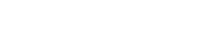Par : Cécilia - team Urbassist
Lecture : 11 min
Lexique de l’urbanisme : 30 termes essentiels à comprendre avant vos travaux
L’urbanisme peut rapidement devenir un casse-tête pour quiconque souhaite réaliser des travaux. Les documents administratifs regorgent de termes techniques parfois obscurs. Comprendre ce vocabulaire est pourtant essentiel pour mener à bien un projet de construction, d’extension ou de rénovation. Pour vous aider à mieux comprendre ces éléments et à avancer plus sereinement dans votre projet, nous vous proposons dans cet article un lexique de l’urbanisme clair et concis de 30 termes incontournables.
Bon à savoir. Pour avancer l’esprit tranquille, vous pouvez compter sur Urbassist pour réaliser votre dossier de déclaration de travaux. En version DIY ou en accompagnement Premium, il y a forcément une formule faite pour vous.
Le lexique des documents d’urbanisme et du cadre réglementaire
Avant même de parler de permis ou de plans, il est important de connaître les grands principes qui structurent l’urbanisme en France. Ces termes généraux sont présents dans tous les projets, car ils définissent le cadre réglementaire dans lequel votre projet de travaux va évoluer. Que vous lisiez un PLU ou que vous échangiez avec votre mairie, ces notions reviennent souvent. Mieux vaut donc les maîtriser dès le début de votre projet de travaux !
1- Carte communale
La carte communale est un document d’urbanisme simplifié. Ce document est principalement utilisé par de petites communes rurales. Moins détaillée qu’un PLU, elle ne contient pas de règlement propre par zone, mais permet tout de même d’organiser le développement du territoire. Bien que moins contraignant, chaque projet entrepris doit respecter les règles en vigueur de la carte communale. La mairie de votre commune pourra vous le fournir.
2- PLU ou Plan Local d’Urbanisme
Document principal fixant les règles d’urbanisme à l’échelle communale ou intercommunale.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document clé qui encadre les règles de construction, d’aménagement et d’usage des sols sur une commune. Il fixe les règles d’urbanisme à l’échelle communale ou intercommunale en définissant notamment les zones constructibles, les hauteurs autorisées, les reculs, et bien plus. Indispensable pour tout projet de travaux ou de construction, le PLU fixe les règles à respecter et reflète la stratégie d’aménagement du territoire. Il est essentiel de découvrir et d’étudier le contenu d’un PLU avant de réfléchir à un projet de travaux et de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme.
3- PPRI ou Plan de Prévention des Risques d’Inondation
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation est un document réglementaire conçu pour réduire la vulnérabilité des populations face aux inondations. Il fait partie des plans de prévention des risques, chacun étant adapté à un type de risque spécifique.
4- PSMV ou Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) à l’instar du PLU, est un document d’urbanisme qui établit des projets d’aménagement et des règles spécifiques. La principale différence réside dans leur champ d’application : le PSMV concerne tout ou partie d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR), tandis que le PLU s’applique à l’ensemble de la commune, à l’exception du territoire couvert par le PSMV. En cas de chevauchement, le PSMV prime sur le PLU.
5- PVAP ou Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
Un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) est un autre document réglementaire, tout comme le PLU ou le PSMV, visant à garantir l’harmonie du territoire de la commune. Cependant, à l’instar du PSMV, son objectif principal est la préservation du patrimoine, et tous deux s’appliquent aux Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR). La différence réside dans le fait que le PVAP couvre uniquement la partie du SPR non incluse dans un PSMV.

6- RNU (Règlement National d’Urbanisme)
Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) intervient en l’absence de PLU ou de carte communale. Il fixe les règles générales pour toute demande d’autorisation d’urbanisme, notamment en ce qui concerne la constructibilité des terrains, les implantations, la hauteur des bâtiments et les distances par rapport aux limites de propriété. Il est essentiel de connaître ses prescriptions avant de déposer un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux afin d’assurer la conformité de votre projet et d’éviter tout refus.
7- Urbanisme
Ensemble des règles et démarches encadrant l’aménagement du territoire et les constructions. L’urbanisme a pour objectif de gérer et contrôler le développement des villes et des territoires pour assurer un équilibre entre logements, infrastructures, espaces verts, activités économiques et mobilité, tout en respectant l’environnement et la qualité de vie des habitants. Concrètement, l’urbanisme définit où et comment construire, rénover ou protéger des espaces, à travers une règlementation spécifique.

Les notions liées à la construction et au terrain
Pour concrétiser un projet de construction ou de rénovation, il est essentiel de maîtriser certains termes techniques qui définissent précisément ce que vous pouvez faire sur votre terrain. Ces notions sont souvent présentes dans les règles d’urbanisme et les autorisations administratives. Comprendre ces concepts vous permettra de mieux respecter les contraintes locales et d’éviter les mauvaises surprises lors de l’instruction de votre dossier de travaux.
8- Alignement
L’alignement correspond à la délimitation, établie par l’autorité administrative, de la frontière entre la voie publique (domaine routier) et les propriétés privées attenantes. (Cf : Section 1 : Alignement, articles L112-1 à L112-7 du Code de la voie routière).
9- Changement de destination
Consiste à convertir un bâtiment d’une destination ou sous-destination en une autre catégorie. Par exemple, transformer une habitation en commerce, un entrepôt en logement ou des bureaux en hôtel. Le terme destination fait référence à la fonction attribuée à un bâtiment et elle est liée aux caractéristiques spécifiques de celui-ci.
10- Emprise au sol
L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume du bâtiment au sol, tous débords et surplombs inclus. Il faut déduire :
- Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises.
- Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
A de l’emprise au sol une surface couverte par un auvent soutenu par des poteaux, un balcon (même sans poteaux) ; les constructions en sous-sol ; une piscine ; une terrasse surélevée de plus de 60 cm par rapport au sol naturel ; un abri non clos mais couvert.
11- Limite séparative
Une limite séparative est la frontière physique (et juridique !) entre deux propriétés privées voisines. Elle délimite précisément jusqu’où s’étend un terrain par rapport à celui du voisin. En urbanisme, cette limite est importante car elle influence les règles d’implantation des constructions, comme les distances à respecter entre un bâtiment et la propriété voisine. Ces règles sont généralement définies dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme) et visent à préserver la sécurité, l’intimité et la bonne cohabitation entre riverains.

12- Servitude d’utilité publique
Il s’agit des charges ou limitations au droit de propriété imposées aux propriétaires des immeubles (bâtiments ou terrains) pour le bénéfice des citoyens. L’Etat ou tout autre personne publique a l’avantage sur les particuliers.
13- Surface de plancher
La surface de plancher est la somme des surfaces closes et couvertes d’un bâtiment, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment en question. Il faut déduire :
- Les surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur.
- Les vides et des trémies des escaliers et ascenseurs.
- Les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m.
- Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non. Y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres.
- Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation. Ou même pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
14- Surface imperméable
Une surface imperméable est une zone recouverte de matériaux (béton, asphalte, pavés, etc.) qui empêchent l’infiltration de l’eau de pluie. L’eau ruisselle alors en surface, rejoignant les canalisations puis les cours d’eau.

15- Secteur protégé
Un secteur protégé est une zone géographique soumise à des règles d’urbanisme spécifiques en raison de son patrimoine historique, architectural, paysager ou environnemental.
16- Périmètre ABF
Il s’agit d’une zone placée sous la surveillance des Architectes des Bâtiments de France (ABF). Dans ce périmètre, tout projet de travaux est soumis à l’avis conforme de l’ABF, qui veille à préserver l’esthétique, l’harmonie architecturale et le patrimoine environnant.
17- Surface habitable
La surface habitable est une notion utilisée principalement en immobilier, notamment lors de la vente ou de la location d’un logement. Définie par le Code de la construction, elle correspond à la surface de plancher après déduction des murs, cloisons, escaliers, gaines et embrasures. C’est un critère essentiel pour évaluer un bien, que ce soit à l’achat, à la location ou en construction.
18- Viabiliser un terrain
Viabiliser un terrain, c’est le préparer à accueillir une future construction. Cela implique de le raccorder aux réseaux essentiels comme l’eau, l’électricité, le gaz, l’assainissement (tout-à-l’égout), les télécommunications (internet et téléphone), ainsi que de créer un accès sécurisé à la voie publique.
19- Zone de préemption
C’est une zone dans laquelle s’applique un droit de préemption urbain. Le droit de préemption urbain (DPU) désigne la priorité de la commune à acquérir des biens immobiliers. L’objectif est de mettre en place des projets et politiques de développement urbain ayant un intérêt général.
Le lexique des autorisations d’urbanisme et démarches administratives
20- Cerfa
Un formulaire Cerfa est un document administratif officiel utilisé pour réaliser une démarche auprès d’une administration française. Il s’agit d’un formulaire standardisé, identifié par un numéro unique, qui permet de centraliser toutes les informations nécessaires à une demande (identité du demandeur, détails de la demande…). Dans le domaine de l’urbanisme, les formulaires Cerfa sont obligatoires pour déposer des autorisations de travaux. Ils sont à remplir avec soin, car une erreur ou un oubli peut retarder l’instruction de votre dossier.
Bon à savoir. Besoin d’aide pour remplir un Cerfa ? Urbassist vous guide pas à pas dans la création de votre dossier d’urbanisme.
21- Certificat d’urbanisme
Le certificat d’urbanisme est un acte administratif informatif. Il est facultatif mais fortement conseillé. En effet, cette démarche permet notamment de connaître les règles d’urbanisme applicables à un terrain. Il existe deux types :
- Le CU d’information (CUa). Il renseigne sur les droits généraux et les servitudes sans se prononcer sur la constructibilité.
- Le CU opérationnel (CUb). Il apporte des informations précises sur la faisabilité d’un projet.
Bien que le CU ne remplace pas une autorisation de construire, il est précieux pour éviter les surprises. Il informe en amont et permet de mieux préparer votre permis ou déclaration préalable.
22- Cotations
Indications des dimensions ou des niveaux faits sur les plans à joindre au dossier de déclaration de travaux.
23- Déclaration préalable de travaux
La déclaration préalable de travaux est une autorisation d’urbanisme requise pour des projets de faible ampleur, comme l’installation d’une piscine, d’un carport, une extension de petite surface, d’un abri de jardin ou encore de panneaux solaires. Elle permet à la mairie de vérifier que votre projet respecte les règles locales d’urbanisme avant toute réalisation.
Le dossier de demande comporte un formulaire Cerfa dédié et divers plans (situation, masse, coupe, façades et/ou insertion paysagère selon le projet). Une fois déposé, la mairie dispose d’un temps pour rendre son avis. C’est ce que l’on appelle le délai d’instruction.

24- Instruction
En urbanisme, l’instruction est la phase durant laquelle la mairie (ou l’administration compétente) étudie votre demande d’autorisation.
Les délais d’instruction sont le temps dont dispose la mairie pour répondre à votre demande. Généralement de 1 à 3 mois.
25- Permis d’aménager
Le permis d’aménager est une autorisation d’urbanisme spécifique. En effet, il est exigé pour certains projets d’aménagement (article R421-12 du Code de l’urbanisme).
26- Permis de construire
Le permis de construire est une autorisation d’urbanisme obligatoire pour les projets de construction ou d’extension de grande ampleur, permettant à la mairie de vérifier la conformité des travaux aux règles locales d’urbanisme.
27- Permis de démolir
Nécessaire dans certaines communes et secteurs pour démolir un bâtiment.
28- Recours des tiers
Droit d’un voisin ou d’un tiers de contester une autorisation de travaux.
29- Sursis à statuer
Correspond à la suspension momentanée d’une procédure telle que l’instruction des demandes d’autorisation de travaux : permis de construire, déclaration préalable ou permis d’aménager.
30- Taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement (TA) est un impôt local qui constitue une participation financière liée à l’urbanisme. Elle est versée principalement à la commune ou au département, tandis qu’en Île-de-France, c’est la région qui en est bénéficiaire.
Pour conclure, en maîtrisant le vocabulaire de l’urbanisme, vous comprendrez plus aisément les documents et démarches d’urbanisme. Cela sera plus confortable pour dialoguer efficacement avec votre mairie ou un professionnel. De plus, cela vous permettra d’éviter les erreurs dans vos démarches administratives.
Vous êtes perdu ou vous ne savez pas par où commencer ? Urbassist vous accompagne dans la création de votre dossier d’urbanisme, en ligne, en toute simplicité.
Vous aimerez aussi...